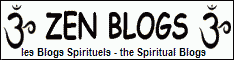L’ABATTOIR
La loi fait obligation de tuer les « animaux de boucherie » dans des abattoirs (sauf dérogations pour les égorgements rituels musulmans ou juifs). Et aussi de les étourdir avant de les tuer (les animaux non tués en abattoir reçoivent 4 à 5 coups de bâton sur la nuque pour être « assommés »). Pour cela, on utilise le plus souvent des tenailles électriques de 90 volts (pour les porcs, les veaux, les moutons) ou bien encore un appareil électrique en forme de fer à cheval ressemblant à un gros aimant (pour les veaux, les vaches, les moutons) ou bien un « pistolet à retenue » où un cylindre de métal vient percuter très violemment la tête de l’animal.
Les animaux deviennent fous lorsqu’ils s’aperçoivent, quand ils le peuvent, que leurs congénères sont battus et électrocutés. Il est scandaleux que des personnes puissent prétendre que les animaux en abattoir sont tués sans souffrance.
Les animaux sont étourdis pour que leur cœur continue à battre et aide ainsi le sang à s’écouler après l’égorgement. Il s’écoule alors par un conduit et est recueilli dans un bac - rien ne se perd. Les employés en tenue bleue ou blanche, selon leur poste, s’affairent sur des tables de travail, suspendent des quartiers de viande à des crocs. Ils scient, découpent, désossent. Les ouvriers ne font même plus attention à ce décor. Ici, pas de sentimentalisme, ni laisser-aller, c’est l’industrie et le travail à la chaîne.
Les boyaux sont traités à part, vidés. Les peaux sont étendues sur le sol et salées : elles seront transformées en sacs à main, valises et chaussures. Les os sont broyés pour faire – entre autre – des engrais. Tout cela a été organisé rationnellement avec tapis roulant, rails garnis de crochets. Les carcasses défilent à une grande vitesse. Direction : le frigo de stockage en attendant l’expédition. Certaines sont conservées entières, d’autres désossées. L’expédition des carcasses ne doit être faite qu’après le délai légal de réfrigération, appelé « ressuage » (24 heures).
L’abattoir est une machine à tuer les animaux industriellement, d’une façon planifiée. On a peine à imaginer que ce sont des êtres conscients qui sont traités de la sorte. Pourtant la réalité est bien là :
Témoignage d’une étudiante en médecine vétérinaire en stage dans un abattoir. Vécu et écrit par C. M. Haupt.
« Seuls les animaux transportés conformément à la Loi sur la protection des animaux (LPA) et possédant une marque d'identification en règle sont acceptés ». C'est l'inscription qui figure au-dessus de la rampe en béton. Au bout de cette rampe gît raide et blafard un cochon mort. « Oui, certains meurent déjà durant le transport. Par collapsus cardiaque ».
J'ai emporté une vieille veste ; bien m'en a pris. Pour un début d'octobre, il fait un froid glacial. Ce n'est pourtant pas pour cette seule raison que je frissonne.
J'enfonce les mains dans mes poches, m'efforce de montrer un visage avenant pour écouter le directeur de l'abattoir m'expliquer qu'on ne procède plus depuis longtemps à un examen complet de chaque bête, seulement à une inspection. Avec 700 cochons par jour, comment cela serait-il possible ?
« Ici, il n'y a aucun animal malade. Si c'est le cas, nous le renvoyons tout de suite, avec une amende salée pour le livreur. S'il le fait une fois, il ne le fera pas une deuxième ». Je baisse la tête comme pour m'excuser – tenir, simplement tenir, tu dois tenir ces six semaines – que deviennent les porcs malades ?
« Il y a un abattoir tout à fait spécial ». Je possède une certaine expérience concernant les règlements relatifs au transport et sais à quel niveau la protection des animaux est à présent reconnue. Ce mot, prononcé dans un tel endroit, a une résonance macabre. Dans l'intervalle, un gros camion d'où s'échappent des cris stridents et de lugubres grognements est venu se ranger face à la rampe. Dans la pénombre du matin, on distingue mal les détails ; toute la scène revêt un aspect irréel et rappelle quelque sinistre reportage de guerre montrant des rangées de wagons gris et les visages blêmes et terrorisés d'une masse de gens humiliés, sur la rampe de chargement, embarqués par des hommes en armes. Tout d'un coup, je m'y trouve dedans, et c'est comme quand on fait un cauchemar dont on se réveille couvert de sueurs froides : au milieu de ce brouillard, par un froid glacial, dans ce demi-jour sale du bâtiment immonde, bloc anonyme de béton, d'acier et de catelles blanches, tout derrière, à la lisière du bois recouvert d'une légère gelée ; ici se passe l'indicible, ce dont personne ne veut rien savoir.
Les cris, c'est la première chose que j'entends chaque matin lorsque j'arrive pour obtenir mon certificat de stage de pratique. Un refus de ma part d'y participer aurait signifié pour moi cinq années d'études perdues et l'abandon de tous mes projets d'avenir. Mais tout en moi – chaque fibre, chaque pensée – n'est que refus, répulsion et effroi, et la conscience d'une insurmontable impuissance : devoir regarder, ne rien pouvoir faire, et ils vont te forcer à coopérer et te souiller de sang. De loin déjà, quand je descends du bus, les cris des cochons me transpercent comme un poignard. Pendant six semaines, des heures durant, sans répit, ces cris retentiront à mes oreilles. Tenir. Pour toi, cela aura une fin. Pour les animaux, jamais.
Une cour déserte, quelques camions frigorifiques, des moitiés de cadavres de cochons pendus à des crochets, aperçus à travers une porte, dans un éclairage aveuglant. Tout ici est d'une propreté méticuleuse. Cela, c'est la façade. Je cherche l'entrée ; elle est située de côté. Deux bétaillères passent devant moi, ses phares jaunes allumés dans la brume matinale. La lumière blanche des fenêtres éclairées me montre le chemin. Après avoir monté quelques marches, je me retrouve à l'intérieur, où tout est carrelé en blanc. Pas d'âme humaine en vue. Ensuite un corridor, blanc lui aussi, et le vestiaire pour les dames. Il est bientôt 7 heures, et je me change : du blanc, du blanc, du blanc ! Mon casque d'emprunt oscille d'une façon grotesque sur mes cheveux raides. Mes bottes sont trop grandes. Je retourne dans le corridor et me range du côté des vétérinaires. Aimables salutations. « Je suis la nouvelle stagiaire ». Avant de continuer, les formalités. « Enfilez un vêtement chaud, allez chez le directeur et remettez-lui votre certificat de santé. Le Dr XX vous dira alors où vous commencerez ».
Le directeur est un homme jovial, qui me parle d'abord du bon vieux temps où l'abattoir n'était pas encore privatisé. Puis s'interrompant à regret, il décide de me faire visiter personnellement les lieux. C'est ainsi que j'arrive sur la rampe. A ma droite des enclos de béton fermés par des barres en fer. Quelques-uns sont prêts, remplis de cochons. « Nous commençons ici à 5 heures du matin ». On les voit se bousculant ici ou se traînant là ; quelques groins curieux arrivent à passer à travers la grille ; des petits yeux méfiants, d'autres fuyants ou en plein désarroi. Une grande truie se jette sur une autre ; le directeur se saisit d'un bâton et la frappe plusieurs fois sur la tête. « Autrement, ils se mordent méchamment ».
En bas de la rampe, le transporteur a abaissé le pont du camion, et les premiers cochons, apeurés par le bruit et la raideur de la pente, se poussent vers l'arrière ; mais entre-temps un convoyeur est monté à l'arrière et distribue des coups de trique en caoutchouc. Je ne m'étonnerai pas, plus tard, de la présence de tant de meurtrissures rouges sur les moitiés de cochons.
« Avec les cochons, il est interdit d'utiliser le bâton électrique » explique le directeur. Certains animaux tentent quelques pas hésitants, en trébuchant parfois. Puis les autres suivent. L'un d'entre eux glisse et sa patte se coince entre la rampe et le pont ; il remonte et continue en boitant. Ils se retrouvent à nouveau entourés de barres de fer qui les mènent inévitablement à un enclos encore vide. Lorsque les cochons, se trouvant à l'avant, arrivent dans un coin, ils s'y entassent en bloc et s'y cramponnent avec fermeté, ce qui fait pousser à l'employé des jurons de colère et cravacher les cochons de l'arrière qui, pris de panique, essaient de grimper par-dessus leurs compagnons d'infortune. Le directeur hoche la tête : « Écervelé, simplement écervelé. Combien de fois ai-je déjà dit qu'il ne servait à rien de frapper les cochons se trouvant à l'arrière ! ».
Pendant que j'assistais, pétrifiée, à cette scène – rien de tout cela n'est réel, tu rêves – le directeur se retourne pour saluer le convoyeur d'un autre transport, arrivé en même temps que le précédent et qui s'apprête à décharger. La raison pour laquelle tout est allé ici beaucoup plus vite, mais avec beaucoup plus de cris, je l'ai tout de suite vu : derrière les porcs qui trébuchent, un deuxième homme apparu dans l'aire de déchargement assène, pour accélérer l'opération, des chocs électriques. Je regarde l'homme, ensuite le directeur : « Vous savez pourtant que c'est interdit avec les porcs ». L'homme regarde étonné, puis range l'instrument dans sa poche.
Par derrière, quelque chose se frotte à moi à la hauteur des genoux ; je me tourne et j'aperçois deux yeux bleus vifs. Je connais de nombreux amis des animaux qui s'enthousiasment pour les yeux animés de sentiments si profonds des chats, pour le regard indéfectiblement fidèle des chiens. Mais qui parle de l'intelligence et de la curiosité perceptibles dans les yeux d'un cochon ? Bientôt, j'apprendrai à les connaître, ces yeux, mais d'une autre manière : muets de peur, abattus de douleur, puis vidés, brisés, exorbités, roulant sur un sol maculé de sang.
Une pensée me traverse l'esprit comme un couteau acéré, et elle me reviendra des centaines de fois au cours des semaines suivantes : Manger de la viande est un crime – un crime...
Après un tour rapide de l'abattoir, je me retrouve dans la salle de pause. Une fenêtre qui s'ouvre sur la salle d'abattage laisse voir des cochons couverts de sang, suspendus, défilant dans une chaîne sans fin. Indifférents, deux employés prennent leur petit déjeuner. Du pain et du saucisson. Leurs tabliers blancs sont couverts de sang. Un lambeau de chair est accroché à la botte de l'un d'eux. Ici, le vacarme inhumain qui m'assourdira lorsque je serai conduite dans la salle d'abattage est atténué. Je reviens en arrière, car une moitié de cadavre de cochon a tourné le coin à vive allure et a heurté la moitié suivante. Elle m'a frôlée, chaude et molle. Ce n'est pas vrai – c'est absurde – impossible.
Tout me tombe dessus en une fois. Les cris perçants. Le grincement des machines. Le bruit métallique des instruments. La puanteur pénétrante des poils et des peaux brûlés. L'exhalaison de sang, et d'eau chaude. Des éclats de rire, des appels insouciants des employés. Des couteaux étincelants passant au travers des tendons pour pendre aux crochets des moitiés d'animaux sans yeux dont les muscles sont encore palpitants. Des morceaux de chair et d'organes tombent dans un caniveau par où du sang s'écoule en abondance, et ce liquide écœurant m'éclabousse. On glisse sur des morceaux de graisse qui jonchent le sol. Des hommes en blanc, sur les tabliers desquels le sang dégouline, avec, sous leurs casques ou leurs képis, des visages comme on peut en voir partout : dans le métro ou au supermarché. Involontairement, on s'attend à voir des monstres, mais c'est le gentil grand-père du voisinage, le jeune homme désinvolte qui déambule dans la rue, le monsieur soigné qui sort d'une banque. On me salue aimablement. Le directeur me montre encore rapidement la halle d'abattage des bovins, vide aujourd'hui. « Les bovins sont là le mardi ». Il me confie alors à une employée en déclarant qu'il a à faire. « Vous pouvez tranquillement visiter seule la halle d'abattage ». Trois semaines s'écouleront avant que je trouve le courage d'y aller.
Le premier jour n'est encore pour moi qu'une sorte de quart d'heure de grâce. Je vais m'asseoir dans une petite pièce à côté de la salle de pause et heure après heure, je découpe en petits morceaux des chairs provenant d'un seau d'échantillons qu'une main tachée de sang remplit régulièrement dans la halle d'abattage. Chacun de ces petits morceaux – un animal. Le tout est alors haché et réparti en portions, auxquelles on ajoute de l'acide chlorhydrique et que l'on fait cuire, pour le test de trichine. L'employée qui m'accompagne me montre tout. On ne trouve jamais de trichine, mais le test est obligatoire.
Le jour suivant, je me rends donc seule dans une partie de la gigantesque machine à découper les morceaux. Une rapide instruction – « Ici, retirer le reste des os du collier de l'arrière-gorge et séparer les nœuds des glandes lymphatiques. Parfois, un sabot pend encore à une patte, il faut l'enlever ». Alors, je découpe, il faut faire vite, la chaîne se déroule sans répit. Au-dessus de moi, d'autres morceaux du cadavre s'éloignent. Mon collègue travaille avec entrain, tandis que dans le caniveau tant de liquide sanguinolent s'accumule que j'en suis éclaboussée jusqu'au visage. J'essaye de me ranger de l'autre côté, mais là une énorme scie à eau coupe en deux les corps des cochons ; impossible d'y rester, sans être trempée jusqu'aux os. En serrant les dents, je découpe encore, mais il faut que je me dépêche, pour pouvoir réfléchir à toute cette horreur, et par-dessus le marché il faut que je fasse diablement attention de ne pas me couper les doigts. Le lendemain, j'emprunterai d'une collègue stagiaire qui a terminé son stage une paire de gants en métal. J'arrête de compter les cochons qui défilent devant moi, ruisselants de sang. Je n'emploierai plus de gants en caoutchouc. Il est vrai qu'il est répugnant de fouiller à mains nues dans des cadavres tièdes, mais si l'on se retrouve plein de sang jusqu'aux épaules, le mélange poisseux des liquides corporels pénètre de toute façon à l'intérieur des gants et rend ces derniers superflus. Pourquoi tourner des films d'horreur, quand tout cela se trouve ici ?
Le couteau est bientôt émoussé. « Donnez-le-moi, je vais vous l'aiguiser ». Le brave grand-père, en réalité un ancien inspecteur des viandes, me lance un clin d'œil. Après m'avoir rapporté le couteau aiguisé, il se met à faire la causette ici et là, me raconte une blague puis se remet au travail. Il me prend désormais un peu sous son aile et me montre quelques trucs qui facilitent quelque peu le travail à la chaîne. « Écoutez, ici tout cela ne vous plaît pas. Je le vois bien. Mais cela doit se faire ». Je ne peux pas le trouver antipathique. Il se donne beaucoup de mal pour me rassurer. La plupart des autres aussi s'efforcent de m'aider ; ils s'amusent certainement à observer ces nombreux stagiaires, qui vont et viennent ici, qui sont d'abord choqués, puis qui poursuivent en serrant les dents leur période de stage. Toutefois, ils demeurent bienveillants. Il n'y a pas de chicaneries. Il me vient à penser que – à part quelques exceptions – les personnes qui travaillent ici ne réagissent pas de façon inhumaine ; elles sont juste devenues indifférentes, comme moi aussi avec le temps. C'est de l'autoprotection. Non, les vrais inhumains sont ceux qui ordonnent quotidiennement ces meurtres de masse, et qui, à cause de leur voracité pour la viande condamnent les animaux à une vie misérable et à une lamentable fin, et forcent d'autres humains à accomplir un travail dégradant qui les transforme en êtres grossiers.
Moi-même, je deviens progressivement un petit rouage de ce monstrueux automatisme de la mort. Au bout d'un certain temps, ces manipulations monotones commencent à devenir automatiques, mais elles restent aussi très pénibles. Menacée d'étouffement par le vacarme assourdissant et l'indescriptible horreur omniprésente, la compréhension reprend le dessus sur les sens hébétés et se remet à fonctionner. Faire la différence, remettre de l'ordre, essayer de discerner. Mais cela est impossible.
Lorsque pour la première fois – en fait, le deuxième ou troisième jour – j'ai pris conscience que le corps saigné, brûlé et scié de l'animal, palpitait encore et que sa petite queue remuait toujours, je n'étais plus en mesure de me mouvoir. « Ils... ils bougent encore. », dis-je, même si en tant que future vétérinaire j'avais appris que c'était les nerfs. J'entends marmonner : « Mince alors, il y en a un qui a fait une faute, il n'est pas tout à fait mort ». Un frémissement spectral agite de partout les moitiés de bêtes. C'est un lieu d'horreur. Je suis glacée jusqu'à la moelle.
Rentrée à la maison, je me couche sur mon lit, les yeux au plafond. Passer les heures, les unes après les autres. Chaque jour. Mon entourage réagit avec irritation. « N'aie pas l'air si renfrognée ; fais donc un sourire. Tu voulais absolument devenir vétérinaire ». Vétérinaire, oui, mais pas tueuse d'animaux. Je ne peux pas me retenir. Ces commentaires. Cette indifférence. Cette évidence de meurtre. Je voudrais, je dois parler, dire ce que j'ai sur le cœur. J'en étouffe. Je voudrais raconter ce que j'ai vu sur le cochon qui ne pouvait plus marcher, progressant tant bien que mal sur son train arrière, jambes de côté ; sur les cochons qui reçoivent des coups de trique et de pied jusqu'à ce qu'ils finissent par entrer dans le box d'abattage. Ce que j'ai vu en me retournant : comment l'animal est scié devant moi et accroché en oscillant : morceaux de muscles partagés en deux parties égales à partir de l'intérieur des cuisses. Nombre d'abattages par jour 530, jamais je ne pourrai oublier ce chiffre. Je voudrais parler de l'abattage des bovins, de leurs doux yeux bruns, remplis de panique. De leurs tentatives d'évasion, de tous les coups et les jurons, jusqu'à ce que la misérable bête soit finalement prisonnière de l'enclos fermé par des barres de fer et une serrure à double tour, avec vue panoramique sur la halle où ses compagnons d'infortune sont dépouillés de leur peau et coupés en morceaux ; puis l'avancée mortelle, et dans le moment qui suit la chaîne que l'on accroche à une patte arrière et dont l'animal tente vainement de se débarrasser en la projetant vers le haut, tandis que, déjà, par en dessous, sa tête est tranchée. Des flots de sang qui giclent à profusion du corps sans tête, tandis que les pattes se recroquevillent… Raconter à propos des bruits atroces de la machine qui arrache la peau du corps, du geste du doigt, circulaire et automatisé, pour ôter le globe de l'œil de son orbite – artère sectionnée, saignante, coulant à flot à l'extérieur – et le jeter dans un trou à même le sol, où il disparaîtra parmi tous les « déchets ». Le bruit provenant des envois sur le dévaloir en aluminium usé, des abats retirés du cadavre décapité et qui ensuite, sauf le foie, le cœur, les poumons et la langue – destinés à la consommation – sont aspirés dans une sorte de collecteur d'ordures.
C'est vrai que je voudrais raconter qu'il arrive toujours qu'au milieu de ces montagnes visqueuses et sanguinolentes se trouve un utérus gravide, et que j'ai vu des petits veaux déjà tout formés, de toutes les tailles, fragiles et nus, les yeux clos, dans une enveloppe utérine qui n'est plus en mesure de les protéger – le plus petit aussi minuscule qu'un chat nouveau-né, et quand même une vache en miniature, le plus grand au poil tendre et soyeux, d'un blanc cassé, avec de longs cils autour des yeux, dont la naissance devait avoir lieu quelques semaines plus tard. « Est-ce que ce n'est pas un miracle, ce que la nature crée ? » constate le vétérinaire de service cette semaine-là, en jetant l'utérus avec le fœtus ensemble dans le gargouillant moulin à déchets. J'ai maintenant la certitude qu'aucun dieu ne peut exister puisque aucun éclair ne vient du ciel pour punir tous ces forfaits commis ici-bas, et que ceux-ci se perpétuent interminablement. Ni pour soulager la vache maigre et pitoyable qui, à mon arrivée à 7 heures le matin, se traîne à bout de force, au prix d'efforts désespérés, dans le couloir glacé, plein de courants d'air, et s'allonge juste devant le box de la mort ; pour elle, il n'existe aucun dieu, ni personne d'ailleurs, pour lui donner une petite tape pour l'aider. Avant tout, il faut traiter le reste des animaux prévus pour l'abattage.
Quand je quitte à midi, la vache est encore couchée et tressaille ; personne, en dépit d'instructions répétées n'est venu la délivrer. J'ai alors desserré le licou qui lui tranchait impitoyablement la chair et lui ai caressé le front. Elle m'a regardé avec ses grands yeux, et j'ai alors appris en cet instant que les vaches pouvaient pleurer. |
|